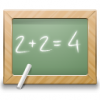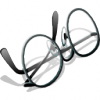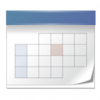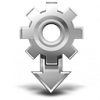Domaine public, mon amour..., une tribune de Yves Riesel

Le saviez-vous ? S'il vous venait l'idée de créer une compilation musicale, vous pouvez librement et sans demander la moindre autorisation y inclure Tous les garçons et les filles de mon âge de Françoise Hardy, Si j'avais un marteau de Claude François ou encore La Javanaise chantée par Juliette Greco !
Curieux non, alors qu'on n'a de cesse de vous rappeler qu'il faut attendre 70 ans après la mort de l'auteur pour voir son œuvre entrer dans le domaine public ? C'est parce qu'ici nous sommes dans le droit voisin du droit d'auteur qui concerne les artistes-interprètes et les producteurs et qui se base non pas sur le décès de l'auteur mais sur la date de première publication de l'œuvre.
Ainsi en France (et jusqu'à preuve du contraire [1]) la durée de protection des droits voisins est de 50 ans à compter du 1er janvier de l'année civile de cette première communication au public. C'est pourquoi le 1er janvier dernier on a guetté [2] l'entrée des nouveaux auteurs morts en 1943 mais également les enregistrements musicaux réalisés au cours de l'année 1963 (comme ceux cités ci-dessus). L'année prochaine ce sera le tour des Copains d'abord de Brassens et A Hard Day's Night des Beatles.
Cependant, le droit d'auteur, lui, subsiste. Si vous commercialisez votre compilation, il faudra bien évidemment verser votre dîme aux ayants droit de Serge Gainsbourg par exemple pour La Javanaise.
Avec son aimable autorisation, nous avons décidé de reproduire ci-dessous un récent article de Yves Riesel, cofondateur du label Abeille Musique et du site de vente de musique en ligne Qobuz, publié initialement dans le magazine Haut Parleur.
Il y évoque cette question des droits voisins et s'insurge, le numérique aidant, contre les médiocres compilations qui inondent le Web et qui font, selon lui, grand tort à la profession. Et d'écorner au passage la BnF qui prend visiblement bien moins soin de ses enregistrements sonores que du reste de son patrimoine.
Domaine public, mon amour...
Par Yves Riesel
Le domaine public fut longtemps le repaire du répertoire classique le plus nichard, et exprimait pour des tarés comme moi des passions sympathiques que les marques « officielles » nous cachaient sur leurs trésors passés. On était au temps du 33 tours, ou du CD. On explorait du répertoire mais on n'avait pas commencé le grand déballage des archives auquel nous assistons maintenant, depuis qu'en numérique, pour rééditer du domaine public il ne faut plus même se donner la peine de presser des CD.
Jadis, quelques rares labels classiques ou de jazz (Pearl, Nimbus, Masters of Jazz, Frémeaux…) réalisaient un travail de grande qualité sonore et documentaire : révélation de galettes et d'artistes oubliés, mention précise des sources, des années, textes de commentaires et de mise en perspective. D'autres, qui travaillaient sur des années à cheval sur le domaine public et la licence en bonne et due forme auprès des labels (Testament, APR, BBC Legends…) montraient que dans le domaine de ces vieilleries, c'est l'éthique, le goût du disque et du risque, le goût de l'histoire du disque qui vaut quelque chose, et non pas la mise à disposition n'importe comment de n'importe quoi auquel personne, à l'exception de rares spécialistes, comprend quelque chose sans information adéquate.
Pour mémoire mais c'est anecdotique, à l'époque où le domaine public y était (20 ans seulement) plus court qu'ailleurs en Europe (50 ans) , des labels italiens dévolus à l'opéra pirate mordaient sur la légalité en publiant des « live » sans aucune clearance des droits. Cela permettait à la marchandise de s'écouler avec le goût du fruit défendu dans des boutiques spécialisées - et même parfois à la Fnac où les plus compétents des gilets verts proclamaient la larme à l'œil (à juste titre) que le disque officiel n'avait jamais donné sa chance à Leyla Gencer, et que le « live » avait réuni des distributions que jamais le disque n'avait pu. Ils avaient raison.
Il n'y avait pas beaucoup de variétés ou de pop dans le domaine public exploité à l'époque parce que, trente ans en arrière, le domaine public s'arrêtait à… 1934 ! Glorieuses années déjà pour le classique, mais côté variétés des vieilleries peu bankables pour l'essentiel. À peine les débuts d'Édith Piaf. La différence est qu'aujourd'hui la frontière est à 1963, et inclut le meilleur du jazz, des pans entiers de la chanson française de qualité des années 40, 50 et début 60, de la VI considérable, et chatouille même les orteils des Beatles et d'Elvis. Du lourd.
Les producteurs se sont battus pour l'allongement des droits car dans le contexte de musique numérique, les fonds de catalogues du début des années 60 deviennent un élément nécessaire de l'équilibre économique de la « long tail » dans le nouveau contexte du streaming. Ils possèdent souvent en outre les sources et la documentation originelle, ce qui leur permet de réaliser un travail qui rend justice à celui de leurs prédécesseurs, aux artistes, et à l'histoire du disque. Ce travail coûte cher à réaliser : rien à voir avec le domaine public qui inonde les serveurs des plateformes de musique en ligne : ceux-là ne paient rien aux producteurs puisque c'est la loi, et n'ont pas même à avancer les droits d'auteurs comme au temps du CD puisque ce sont les plateformes qui les paient au niveau de la vente finale. Ils peuvent rééditer le son mais n'ont pas le droit de reprendre les pochettes originales, une preuve de plus que les méchants producteurs phono sont moins bien protégés que les photographes ou les graphistes. Ce qu'ils balancent dans les tuyaux est brut de repiquage, sans aucune information permettant de s'y retrouver ou de comprendre. Si le son est le plus souvent mauvais ou sans intérêt, c'est moins grave selon moi que l'absence totale de crédits sur ce qu'on écoute.
Avec l'arrivée de la distribution numérique c'est comme du chiendent : une nuée d'opportunistes se sont abattus sur des artistes tels que Charles Trenet, Miles Davis, Louis Armstrong, Peggy Lee, j'en passe et des meilleurs. Chaque jour que Dieu fait, ces gens livrent et re-livrent aux plateformes les mêmes albums ou les mêmes compiles, avec des pochettes inqualifiables, afin d'occuper la première place des fameux algorithmes savants et miraculeux (hihihi) des moteurs de recherches des champions de la musique en ligne. Chaque matin voit arriver son lot de nouveaux best-of pourris de Juliette Greco ou autres gloires. Ils induisent en erreur les utilisateurs. Et comme il y a beaucoup plus de rééditions que de vrais albums, les domaines publics véreux engloutissent les revenus des producteurs légitimes qui dépensent des sommes conséquentes pour rafraichir, d'après les bandes originales et non pas d'après des copies de copies, les albums originaux. Écoutez le travail splendide réalisé, exemple, par Universaĺ sur « ses » Jacques Brel, et redécouvrez voluptueusement les arrangements de François Rauber. A l'inverse, Qobuz affiche ce jour… 2767 albums de Miles Davis ! On aimerait que ce soit vrai. Et encore, nous passons notre temps à écrémer. Loufoque.
La loi sur le domaine public, même étendue a 70 ans, est une loi équilibrée, sympathique, assez généreuse en somme, plus généreuse qu'aux États-Unis où Mickey est protégé 95 ans. Il faut la voir comme une loi favorable à une exploration culturelle, et il y a beaucoup à faire sur les années tombées dans le domaine public - si du moins on ne la travestit pas dans un souci de lucre idiot. Le domaine public devrait être ce champ de recherches merveilleux permettant d'offrir au public intéressé des documents pour beaucoup inestimables, et un outil d'éducation à notre patrimoine sonore pour les nouveaux publics. Pour l'instant, c'est seulement une caverne d'Ali Baba exploitée, pillée n'importe comment.
Cette situation, on peut l'admettre sinon l'accepter de la part de types travaillant dans leur coin avec une vieil électrophone et un ordinateur. Elle est inacceptable en revanche s'agissant de la Bibliothèque Nationale de France dont la Collection sonore de réédition de son Dépôt légal, sur le principe excitante, n'est en rien à la hauteur de la signature scientifique de la maison.
Si le sort documentaire réservé au disque dans la collection sonore de la BNF était pareillement réservé à ses estampes ou à ses vieux papiers, présentés sans notice scientifique minimum, sans datation précise et adéquate, cela ferait un scandale. Bruno Racine n'a pas mobilisé comme il le fallait son équipe de fonctionnaires dont c'est pourtant le rôle culturel éminent, et il a eu tort – on en voudra moins aux sous-traitant ou partenaires de la BnF qui ne sont pas des archivistes ou des scientifiques. Alors que j'ai espéré, avec des arguments polis, attirer l'attention de Racine sur ce problème sérieux (d'ailleurs financé par le Grand emprunt), il m'a fait une réponse de deux pages niant l'évidence, complètement à côté de la plaque. Et quant aux gens en principe sympathiques et compétents chargés à la BnF de ces choses là, c'est un silence gêné.
Mais que voulez-vous, le disque en France, contre toute évidence, n'est toujours pas considéré comme un objet d'édition culturelle ni comme un objet d'études.
Le disque, malgré plus d'un siècle d'histoire, en France c'est vu comme du show-biz, des âneries, de la chansonnette.
À côté de quoi, quel soin et quel argent pour rééditer de vieux nanards du cinéma français !
Non, je ne vais pas évoquer le projet avorté du CNM et ce qu'il contenait pourtant de bien intéressant…
[1] En 2011, le parlement européen a décidé (sous la pression de certains lobbys ?) de prolonger de 50 à 70 ans la durée des droits voisins mais cette directive tarde à être transposée en droit national.
[2] Voir cette chronique de France Info Aux bonheurs du domaine public.