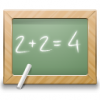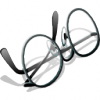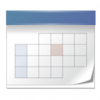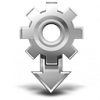Le domaine public payant, selon Victor Hugo (1878)

Domaine public : la règle ou l'exception ? Tel était l'intitulé d'un atelier qui s'est déroulé le 17 avril dernier lors des Rencontres Européennes de l'ADAMI où nous étions invités (compte rendu sur Next INpact).
La table ronde s'est ouverte de manière originale par une intervention surprise de Pierre Santini, récitant avec brio le discours de Victor Hugo donné le 25 juin 1878 dans le cadre du IIIe Congrès littéraire international.
Avec l'aimable autorisation de l'ADAMI et de Pierre Santini.
Texte intégral
Messieurs, permettez-moi d'entrer en toute liberté dans la discussion. Je ne comprends rien à la déclaration de guerre qu'on fait au domaine public.
Comment ! on ne publie donc pas les œuvres de Corneille, de La Fontaine, de Racine, de Molière ? Le domaine public n'existe donc pas ? Où sont, dans le présent, ces inconvénients, ces dangers, tout ce dont le Cercle de la librairie nous menace pour l'avenir ?
Toutes, ces objections, on peut les faire au domaine public tel qu'il existe aujourd'hui.
Le domaine public est détestable, dit-on, à la mort de l'auteur, mais il est excellent aussitôt qu'arrivé l'expiration… de quoi ? De la plus étrange rêverie que jamais des législateurs aient appliquée à un mode de propriété, du délai fixé pour l'expropriation d'un livre.
Vous entrez là dans la fantaisie irréfléchie de gens qui ne s'y connaissent pas. Je parle des législateurs, et j'ai le droit d'en parler avec quelque liberté. Les hommes qui font des lois quelquefois s'y connaissent ; ils ne s'y connaissent pas en matière littéraire. ( Rires approbatifs.)
Sont-ils d'accord au moins entre eux ? Non. Le délai de protection qu'ils accordent est ici de dix ans, là de vingt ans, plus loin de cinquante ans ; ils vont même jusqu'à quatre-vingts ans. Pourquoi ? Ils n'en savent rien. Je les défie de donner une raison.
Et c'est sur cette ignorance absolue des législateurs que vous voulez fonder, vous qui vous y connaissez, une législation ! Vous qui êtes compétents, vous accepterez l'arrêt rendu par des incompétents !
Qui expliquera les motifs pour lesquels, dans tous les pays civilisés, la législation attribue à l'héritier, après la mort de son auteur, un laps de temps variable, pendant lequel l'héritier, absolu maître de l'œuvre, peut la publier ou ne pas la publier ? Qui expliquera l'écart que les diverses législations ont mis entre la mort de l'auteur et l'entrée en possession du domaine public ?
Il s'agit de détruire cette capricieuse et bizarre invention de législateurs ignorants. C'est à vous, législateurs indirects mais compétents, qu'il appartient d'accomplir cette tâche.
En réalité, qu'ont-ils considéré, ces législateurs qui, avec une légèreté incompréhensible, ont légiféré sur ces matières ? Qu'ont-ils pensé ? Ont-ils cru entrevoir que l'héritier du sang était l'héritier de l'esprit ? Ont-ils cru entrevoir que l'héritier du sang devait avoir la connaissance de la chose dont il héritait, et que, par conséquent, en lui remettant le droit d'en disposer, ils faisaient une loi juste et intelligente ?
Voilà où ils se sont largement trompés. L'héritier du sang est l'héritier du sang. L'écrivain, en tant qu'écrivain, n'a qu'un héritier, c'est l'héritier de l'esprit, c'est l'esprit humain, c'est le domaine public. Voilà la vérité absolue.
Les législateurs ont attribué à l'héritier du sang une faculté qui est pleine d'inconvénients, celle d'administrer une propriété qu'il ne connaît pas, ou du moins qu'il peut ne pas connaître. L'héritier du sang est le plus souvent à la discrétion de son éditeur. Que l'on conserve à l'héritier du sang son droit, et que l'on donne à l'héritier de l'esprit ce qui lui appartient, en établissant le domaine public payant, immédiat.
Eh quoi ! immédiat ? Ici arrive une objection, qui n'en est pas une. Ceux qui l'ont faite n'avaient pas entendu mes paroles. On me dit : Comment ! le domaine public s'emparera immédiatement de l'œuvre ? Mais si l'auteur l'a vendue pour dix ans, pour vingt ans, celui qui l'a achetée va donc être dépossédé ? Aucun éditeur ne voudra plus acheter une œuvre.
J'avais dit précisément le contraire, le texte est là. J'avais dit : « Sauf réserve des concessions faites par l'auteur de son vivant, et des contrats qu'il aura signés. »
Il en résulte que si vous avez vendu à un éditeur pour un laps de temps déterminé la propriété d'une de vos œuvres, le domaine public ne prendra possession de cette œuvre qu'après le délai fixé par vous.
Mais ce délai peut-il être illimité ? Non. Vous savez, messieurs, que la propriété, toute sacrée qu'elle est, admet cependant des limites. Je vous dis une chose élémentaire en vous disant : on ne possède pas une maison comme on possède une mine, une forêt, comme un littoral, un cours d'eau, comme un champ. La propriété, il y a des jurisconsultes qui m'entendent, est limitée selon que l'objet appartient, dans une mesure plus ou moins grande, à l'intérêt général. Eh bien, la propriété littéraire appartient plus que toute autre à l'intérêt général ; elle doit subir aussi des limites. La loi peut très bien interdire la vente absolue, et accorder à l'auteur, par exemple, au maximum cinquante ans. Je crois qu'il n'y a pas d'auteur qui ne se contente d'une possession de cinquante ans.
Voilà donc un argument qui s'écroule. Le domaine public payant immédiat ne supprime pas la faculté qu'un auteur a de vendre son livre pour un temps déterminé ; l'auteur conserve tous ses droits.
Second argument : Le domaine public payant immédiat, en créant une concurrence énorme, nuira à la fois aux auteurs et aux éditeurs. Les livres ne trouveront plus d'éditeurs sérieux.
Je suis étonné que les honorables représentants de la librairie qui sont ici soutiennent une thèse semblable et fassent « comme s'ils ne savaient pas ». Je vais leur rappeler ce qu'ils savent très bien, ce qui arrive tous les jours. Un auteur vend, de son vivant, l'exploitation d'un livre, sous telle forme, à tel nombre d'exemplaires, pendant tel temps, et stipule le format et quelquefois même le prix de vente du livre. En même temps, à un autre éditeur, il vend un autre format, dans d'autres conditions. À un autre, un mode de publication différent ; par exemple, une édition illustrée à deux sous. Il y a quelqu'un qui vous parle ici et qui a sept éditeurs.
Aussi, quand j'entends des hommes que je sais compétents, des hommes que j'honore et que j'estime, quand je les entends dire : On ne trouvera pas d'éditeurs, en présence de la concurrence et de la liberté illimitée de publication, pour acheter et éditer un livre, — je m'étonne. Je n'ai proposé rien de nouveau ; tous les jours, on a vu, on voit, du vivant de l'auteur et de son consentement, plusieurs éditeurs, sans se nuire entre eux, et même en se servant entre eux, publier le même livre. Et ces concurrences profitent à tous, au public, aux écrivains, aux libraires.
Est-ce que vous voyez une interruption dans la publication des grandes œuvres des grands écrivains français ? Est-ce que ce n'est pas là le domaine le plus exploité de la librairie ?
Marques d'approbation.
Maintenant qu'il est bien entendu que l'entrée en possession du domaine public ne gène pas l'auteur et lui laisse le droit de vendre la propriété de son œuvre ; maintenant qu'il me semble également démontré que la concurrence peut s'établir utilement sur les livres, après la mort de l'auteur aussi bien que pendant sa vie, revenons à la chose en elle-même.
Supposons le domaine public payant, immédiat, établi.
Il paie une redevance. J'ai dit que cette redevance devrait être légère. J'ajoute qu'elle devrait être perpétuelle. Je m'explique.
S'il y a un héritier direct, le domaine public paie à cet héritier direct la redevance ; car remarquez que nous ne stipulons que pour l'héritier direct, et que tous les arguments qu'on fait valoir au sujet des héritiers collatéraux et de la difficulté qu'on aurait à les découvrir, s'évanouissent.
Mais, à l'extinction des héritiers directs, que se passe-t-il ?
Le domaine public va-t-il continuer d'exploiter l'œuvre sans payer de droits, puisqu'il n'y a plus d'héritiers directs ? Non ; selon moi, il continuerait d'exploiter l'œuvre en continuant de payer la redevance.
À qui ?
C'est ici, messieurs, qu'apparaît surtout l'utilité de la redevance perpétuelle.
Rien ne serait plus utile, en effet, qu'une sorte de fonds commun, un capital considérable, des revenus solides, appliqués aux besoins de la littérature en continuelle voie de formation. Il y a beaucoup de jeunes écrivains, de jeunes esprits, de jeunes auteurs, qui sont pleins de talent et d'avenir, et qui rencontrent, au début, d'immenses difficultés. Quelques-uns ne percent pas, l'appui leur a manqué, le pain leur a manqué. Les gouvernements, je l'ai expliqué dans mes premières paroles publiques, ont créé le système des pensions, système stérile pour les écrivains. Mais supposez que la littérature française, par sa propre force, par ce décime prélevé sur l'immense produit du domaine public, possède un vaste fonds littéraire, administré par un syndicat d'écrivains, par cette société des gens de lettres qui représente le grand mouvement intellectuel de l'époque ; supposez que votre comité ait cette très grande fonction d'administrer ce que j'appellerai la liste civile de la littérature. Connaissez-vous rien de plus beau que ceci : toutes les œuvres qui n'ont plus d'héritiers directs tombent dans le domaine public payant, et le produit sert à encourager, à vivifier, à féconder les jeunes esprits !
Adhésion unanime.
Y aurait-il rien de plus grand que ce secours admirable, que cet auguste héritage, légué par les illustres écrivains morts aux jeunes écrivains vivants ?
Est-ce que vous ne croyez pas qu'au lieu de recevoir tristement, petitement, une espèce d'aumône royale, le jeune écrivain entrant dans la carrière ne se sentirait pas grandi en se voyant soutenu dans son œuvre par ces tout-puissants génies, Corneille et Molière ?
Applaudissements prolongés.
C'est là votre indépendance, votre fortune. L'émancipation, la mise en liberté des écrivains, elle est dans la création de ce glorieux patrimoine. Nous sommes tous une famille, les morts appartiennent aux vivants, les vivants doivent être protégés par les morts. Quelle plus belle protection pourriez-vous souhaiter ?
Explosion de bravos.
Je vous demande avec instance de créer le domaine public payant dans les conditions que j'ai indiquées. Il n'y a aucun motif pour retarder d'une heure la prise de possession de l'esprit humain
Longue salve d'applaudissements.
Annexe : Le discours de la séance du 21 juin
Présidence de Victor Hugo.
Puisque vous désirez, messieurs, connaître mon avis, je vais vous le dire. Ceci, du reste, est une simple conversation.
Messieurs, dans cette grave question de la propriété littéraire il y a deux unités en présence : l'auteur et la société. Je me sers de ce mot unité pour abréger ; ce sont comme deux personnes distinctes.
Tout à l'heure nous allons aborder la question d'un tiers, l'héritier. Quant à moi, je n'hésite pas à dire que le droit le plus absolu, le plus complet, appartient à ces deux unités : l'auteur qui est la première unité, la société qui est la seconde.
L'auteur donne le livre, la société l'accepte ou ne l'accepte pas. Le livre est fait par l'auteur, le sort du livre est fait par la société.
L'héritier ne fait pas le livre ; il ne peut avoir les droits de l'auteur. L'héritier ne fait pas le succès ; il ne peut avoir le droit de la société.
Je verrais avec peine le congrès reconnaître une valeur quelconque à la volonté de l'héritier.
Ne prenons pas de faux points de départ.
L'auteur sait ce qu'il fait ; la société sait ce qu'elle fait ; l'héritier, non. Il est neutre et passif.
Examinons d'abord les droits contradictoires de ces deux unités : l'auteur qui crée le livre, la société qui accepte ou refuse cette création.
L'auteur a évidemment un droit absolu sur son œuvre, ce droit est complet. Il va très loin, car il va jusqu'à la destruction. Mais entendons-nous bien sur cette destruction.
Avant la publication, l'auteur a un droit incontestable et illimité. Supposez un homme comme Dante, Molière, Shakespeare. Supposez-le au moment où il vient de terminer une grande œuvre. Son manuscrit est là, devant lui, supposez qu'il ait la fantaisie de le jeter au feu, personne ne peut l'en empêcher. Shakespeare peut détruire Hamlet ; Molière, Tartuffe ; Dante, l' Enfer.
Mais dès que l'œuvre est publiée l'auteur n'en est plus le maître. C'est alors l'autre personnage qui s'en empare, appelez-le du nom que vous voudrez : esprit humain, domaine public, société. C'est ce personnage-là qui dit : Je suis là, je prends cette œuvre, j'en fais ce que je crois devoir en faire, moi esprit humain ; je la possède, elle est à moi désormais. Et, que mon honorable ami M. de Molinari me permette de le lui dire, l'œuvre n'appartient plus à l'auteur lui-même. Il n'en peut désormais rien retrancher ; ou bien, à sa mort tout reparaît. Sa volonté n'y peut rien. Voltaire du fond de son tombeau voudrait supprimer la Pucelle ; M. Dupanloup la publierait.
L'homme qui vous parle en ce moment a commencé par être catholique et monarchiste. Il a subi les conséquences d'une éducation aristocratique et cléricale. L'a-t-on vu refuser l'autorisation de rééditer des œuvres de sa presque enfance ? Non.
Bravo ! bravo !
J'ai tenu à marquer mon point de départ. J'ai voulu pouvoir dire : Voilà d'où je suis parti et voilà où je suis arrivé.
J'ai dit cela dans l'exil : Je suis parti de la condition heureuse et je suis monté jusqu'au malheur qui est la conséquence du devoir accompli, de la conscience obéie.
Applaudissements.
Je ne veux pas supprimer les premières années de ma vie.
Mais je vais bien plus loin, je dis : il ne dépend pas de l'auteur de faire une rature dans son œuvre quand il l'a publiée. Il peut faire une correction de style, il ne peut pas faire une rature de conscience. Pourquoi ? Parce que l'autre personnage, le public, a pris possession de son œuvre.
Il m'est arrivé quelquefois d'écrire des paroles sévères, que plus tard j'aurais voulu, par un sentiment de mansuétude, effacer. Il m'est arrivé un jour… je puis vous dire cela, de flétrir le nom d'un homme très coupable ; et j'ai certes bien fait de flétrir ce nom. Cet homme avait un fils. Ce fils a eu une fin héroïque, il est mort pour son pays. Alors j'ai usé de mon droit, j'ai interdit que ce nom fût prononcé sur les théâtres de Paris où on lisait publiquement les pièces dont je viens de vous parler. Mais il n'a pas été en mon pouvoir d'effacer de l'œuvre le nom déshonoré. L'héroïsme du fils n'a pas pu effacer la faute du père.
Bravos.
Je voudrais le faire, je ne le pourrais pas. Si je l'avais pu, je l'aurais fait.
Vous voyez donc à quel point le public, la conscience humaine, l'intelligence humaine, l'esprit humain, cet autre personnage qui est en présence de l'auteur, a un droit absolu, droit auquel on ne peut toucher. Tout ce que l'auteur peut faire, c'est d'écrire loyalement. Quant à moi, j'ai la paix et la sérénité de la conscience. Cela me suffit.
Applaudissements.
Laissons notre devoir et laissons l'avenir juger. Une fois l'auteur mort, une fois l'auteur disparu, son œuvre n'appartient plus qu'à sa mémoire, qu'elle flétrira ou glorifiera.
C'est vrai ! Très bien !
Je déclare, que s'il me fallait choisir entre le droit de l'écrivain et le droit du domaine public, je choisirais le droit du domaine public. Avant tout, nous sommes des hommes de dévouement et de sacrifice. Nous devons travailler pour tous avant de travailler pour nous.
Cela dit, arrive un troisième personnage, une troisième unité à laquelle je prends le plus profond intérêt ; c'est l'héritier, c'est l'enfant. Ici se pose la question très délicate, très curieuse, très intéressante, de l'hérédité littéraire, et de la forme qu'elle devrait avoir.
Je vous demande la permission de vous soumettre rapidement, à ce nouveau point de vue, les idées qui me paraissent résulter de l'examen attentif que j'ai fait de cette question.
L'auteur a donné le livre.
La société l'a accepté.
L'héritier n'a pas à intervenir. Cela ne le regarde pas.
Joseph de Maistre, héritier de Voltaire, n'aurait pas le droit de dire : Je m'y connais.
L'héritier n'a pas le droit de faire une rature, de supprimer une ligne ; il n'a pas le droit de retarder d'une minute ni d'amoindrir d'un exemplaire la publication de l'œuvre de son ascendant.
Bravo ! bravo ! Très bien !
Il n'a qu'un droit : vivre de la part d'héritage que son ascendant lui a léguée.
Messieurs, je le dis tout net, je considère toutes les formes de la législation actuelle qui constituent le droit de l'héritier pour un temps déterminé comme détestables. Elles lui accordent une autorité qu'elles n'ont pas le droit de lui donner, et elles lui accordent le droit de publication pour un temps limité ; ce qui est en partie sans utilité : la loi est très aisément éludée.
L'héritier, selon moi, n'a qu'un droit, je le répète : vivre de l'œuvre de son ascendant ; ce droit est sacré, et certes il ne serait pas facile de me faire déshériter nos enfants et nos petits-enfants. Nous travaillons d'abord pour tous les hommes, ensuite pour nos enfants.
Mais ce que nous voulons fermement, c'est que le droit de publication reste absolu et entier à la société. C'est le droit de l'intelligence humaine.
C'est pour cela qu'il y a beaucoup d'années-je suis de ceux qui ont la tristesse de remonter loin dans leurs souvenirs-j'ai proposé un mécanisme très simple qui me paraissait, et me paraît encore, avoir l'avantage de concilier tous les droits des trois personnages, l'auteur, le domaine public, l'héritier. Voici ce système : L'auteur mort, son livre appartient au domaine public ; n'importe qui peut le publier immédiatement, en pleine liberté, car je suis pour la liberté. À quelles conditions ? Je vais vous le dire.
Il existe dans nos lois un article qui n'a pas de sanction, ce qui fait qu'il a été très souvent violé. C'est un article qui exige que tout éditeur, avant de publier une œuvre, fasse à la direction de la librairie, au ministère de l'intérieur, une déclaration portant sur les points que voici :
Quel est le livre qu'il va publier ;
Quel en est l'imprimeur ;
Quel sera le format ;
Quel est le nom de l'auteur.
Ici s'arrête la déclaration exigée par la loi. Je voudrais qu'on y ajoutât deux autres indications que je vais vous dire.
L'éditeur serait tenu de déclarer quel serait le prix de revient pour chaque exemplaire du livre qu'il entend publier et quel est le prix auquel il entend le vendre. Entre ces deux prix, dans cet intervalle, est inclus le bénéfice de l'éditeur.
Cela étant, vous avez des données certaines : le nombre d'exemplaires, le prix de revient et le prix de vente, et vous pouvez, de la façon la plus simple, évaluer le bénéfice.
Ici on va me dire : Vous établissez le bénéfice de l'éditeur sur sa simple déclaration et sans savoir s'il vendra son édition ? Non, je veux que la loi soit absolument juste. Je veux même qu'elle incline plutôt en faveur du domaine public que des héritiers. Aussi je vous dis : l'éditeur ne sera tenu de rendre compte du bénéfice qu'il aura fait que lorsqu'il viendra déposer une nouvelle déclaration. Alors on lui dit : Vous avez vendu la première édition, puisque vous voulez en publier une seconde, vous devez aux héritiers leurs droits. Ce droit, messieurs, ne l'oubliez pas, doit être très modéré, car il faut que jamais le droit de l'héritier ne puisse être une entrave au droit du domaine public, une entrave à la diffusion des livres. Je ne demanderais qu'une redevance de cinq ou dix pour cent sur le bénéfice réalisé.
Aucune objection possible. L'éditeur ne peut pas trouver onéreuse une condition qui s'applique à des bénéfices acquis et d'une telle modération ; car s'il a gagné mille francs on ne lui demande que cent francs et on lui laisse neuf cents francs. Vous voyez à quel point lui est avantageuse la loi que je propose et que je voudrais voir voter.
Je répète que ceci est une simple conversation. Je cherche, nous cherchons tous, mutuellement, à nous éclairer. J'ai beaucoup étudié cette question dans l'intérêt de la lumière et de la liberté.
Y a-t-il des objections ? j'avoue que je ne les trouve pas. Je vois s'écrouler toutes les objections à l'ancien système ; tout ce qui a été dit sur la volonté bonne ou mauvaise d'un héritier, sur un évêque confisquant Voltaire, cela a été excellemment dit, cela était juste dans l'ancien système ; dans le mien cela s'évanouit.
L'héritier n'existe que comme partie prenante, prélevant une redevance très faible sur le produit de l'œuvre de son ascendant. Sauf les concessions faites et stipulées par l'auteur de son vivant, contrats qui font loi, sauf ces réserves, l'éditeur peut publier l'œuvre à autant d'exemplaires qu'il lui convient, dans le format qu'il lui plaît ; il fait sa déclaration, il paie la redevance et tout est dit.
Ici une objection, c'est que notre loi a une lacune. Il y a dans cette assemblée des jurisconsultes ; ils savent qu'il n'y a pas de prescription sans sanction ; or, la prescription relative à la déclaration n'a pas de sanction. L'éditeur fait la déclaration qui lui est imposée par la loi, s'il le veut. De là beaucoup de fraudes dont les auteurs dès à présent sont victimes. Il faudrait que la loi attachât une sanction à cette obligation.
Je désirerais que les jurisconsultes voulussent bien l'indiquer eux-mêmes. Il me semble qu'on pourrait assimiler la fausse déclaration faite par un éditeur à un faux en écriture publique ou privée. Ce qui est certain, c'est qu'il faut une sanction ; ce n'est, à mon sens, qu'à cette condition qu'on pourra utiliser le système que j'ai l'honneur de vous expliquer, et que j'ai proposé il y a de longues années.
Ce système a été repris avec beaucoup de loyauté et de compétence par un éditeur distingué que je regrette de ne pas voir ici, M. Hetzel ; il a publié sur ce sujet un excellent écrit.
Une telle loi à mon avis serait utile. Je ne dispose certainement pas de l'opinion des écrivains très considérables qui m'écoutent, mais il serait très utile que dans leurs résolutions ils se préoccupassent de ce que j'ai eu l'honneur de leur dire :
1° Il n'y a que deux intéressés véritables : l'écrivain et la société ; l'intérêt de l'héritier, quoique très respectable, doit passer après.
2° L'intérêt de l'héritier doit être sauvegardé, mais dans des conditions tellement modérées que, dans aucun cas, cet intérêt ne passe avant l'intérêt social.
Je suis sûr que l'avenir appartient à la solution que je vous ai proposée.
Si vous ne l'acceptez pas, l'avenir est patient, il a le temps, il attendra.
Applaudissements prolongés. L'assemblée vote, à l'unanimité, l'impression de ce discours.
Illustration : Victor Hugo - Nadar - Licence : Domaine public (source : Wikimedia Commons)